
Le film Emmanuelle est sorti il y 50 ans, au début de l’été 1974. Derrière le film érotique à succès, il y a un mystère : est-ce un film sur la libération des femmes ou sur la carcan patriarcal ? Cette question paradoxale pour un film sur la libération sexuelle reste un mystère à expliquer
Mais en faveur d’une vision plus masculine, il y a une intrigue où hommes et femmes s’inscrivent dans des rôles et une sexualité prédéfinis fondés sur une relation dominant-dominé assez classique. Surtout il semble que le roman ait été écrit à 4 mains avec le mari de la romancière, voir selon certains témoignages par lui seul qui aurait utilisé sa femme de 19 ans alors pour protéger sa carrière de diplomate à Bangkok, justement la profession de Jean, le mari que vient retrouver Emmanuelle dans le roman/film.
Le film Emmanuelle aurait dû être interdit à cause de la censure. Mais la mort du Président Pompidou conduit au changement du ministre de la culture et à une politique des mœurs plus laxiste. Emmanuelle peut sortir en version intégrale pour devenir le plus grand succès de la décennie (près de 9 millions d’entrées sur 11 ans) et un triomphe à l’international. C’est une porte qui s’ouvre : l’année suivante, les films pornographiques représenteront 1 entrée sur 5 à Paris. Il faudra à nouveau réguler.
Derrière le film, il y a l’intuition d’un jeune notaire ambitieux, Yves Rousset-Rouard, qui chercha à devenir producteur en s’inspirant du succès du Dernier tango à Paris, drame érotique avec Marlon Brando. Il imagina pouvoir confier à l’acteur américain le rôle de Mario, mais dû se contenter d’Alain Cluny bien connu aussi des cinéphiles notamment pour son rôle dans les visiteurs du soir de Marcel Carné.
Ayant peu d’argent, il recruta un photographe de mode et réalisateur de documentaires, Just Jaeckin, qui n’avait encore jamais fait de film. C’est à la télévision que celui-ci repère un illustrateur sonore inconnu à qui il confie la musique, Pierre Bachelet, dont le succès de la bande originale lancera sa belle carrière dans la variété française.
Quant au rôle principal, il revint à Sylvia Kristel, jeune mannequin hollandais également débutante. Celle-ci eut beaucoup de mal à se défaire de ce rôle (malgré sa prestation dans Alice ou la dernière fugue de Claude Chabrol). Si le personnage d’Emmanuelle contribua à la libération des femmes, il eu pour effet au contraire d’enfermer son actrice principale.
Et le producteur ? Grâce à ce succès, il entreprit de produire une pièce, puis un film écrit par son neveu, Christian Clavier, avec des copains de théâtre : les Bronzés. Avant de devenir député.























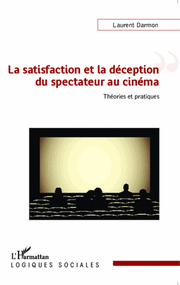

 Flux RSS
Flux RSS

