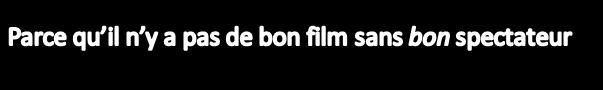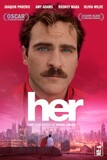
Il y a juste dix ans sortait en France Her, film d’anticipation jugé mineur à l’époque mais devenu prophétique du monde dans lequel nous rentrons. Un léger décalage de notre univers domestique et affinitaire où l’Intelligence Artificielle s’invite pour explorer l’âme humaine à la façon d’un épisode de luxe de la série Black mirror.
En 1950, Alan Turing anticipait cela en affirmant : « je parie que dans cinquante ans il n’y aura plus moyen de distinguer les réponses données par un homme ou un ordinateur, et ce sur n’importe quel sujet ». À une génération d’écart, on y est bien. L’IA sait merveilleusement simuler l’intelligence, l’empathie et les émotions comme dans le film.
Quelle ironie de voir en 2024 Scarlett Johansson attaquer une société pour avoir reproduit grâce à l’IA sa voix au timbre si singulier à des fins publicitaires.
Si pour Scarlett Johansson, on est dans le deepfake sans consentement, que penser de Bruce Willis qui a donné son accord pour continuer à jouer la comédie alors qu’il est frappé d’aphasie ?
Le film, visionnaire, pose la question de l’impact social de la technologie et des bulles cognitives : un accès élargi à la connaissance et aux interactions (in)humaines ou un risque élevé pour notre notre libre-arbitre et le sens des réalités ? La qualité impressionnante de l’écran du nouvel Apple Vision Pro amène progressivement à une immersion proche du metaverse ultra-réaliste de Ready Player One qui conduit cette fois au risque de confusion psychologique entre réalité et virtuel. Cela renforce notre tendance à trouver un sens dans les interactions numériques. La techno-dépendance décrite dans Her se renforce un peu plus.
Refusant tout manichéisme, le réalisateur Spike Jonze illustre le contraste entre la proximité physique des individus dans les espaces urbains et leur distance émotionnelle. Dans Her, il explore la manière dont les technologies avancées peuvent à la fois combler le vide émotionnel des individus et accentuer leur isolement social.
Fable sur l’ « ultra moderne solitude » à l’heure de l’hyper-connectivité, le film ouvre surtout une réflexion philosophique sur ce qui fait notre humanité, entre apprentissage de la souffrance et développement de relations sociales authentiques.
Très contemporain, Her n’est finalement plus vraiment un film d’anticipation mais il appartient à chacun de le qualifier, entre utopie ou dystopie.
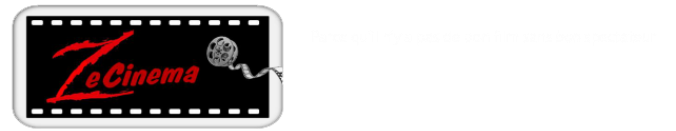
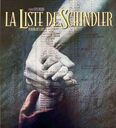


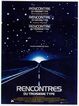


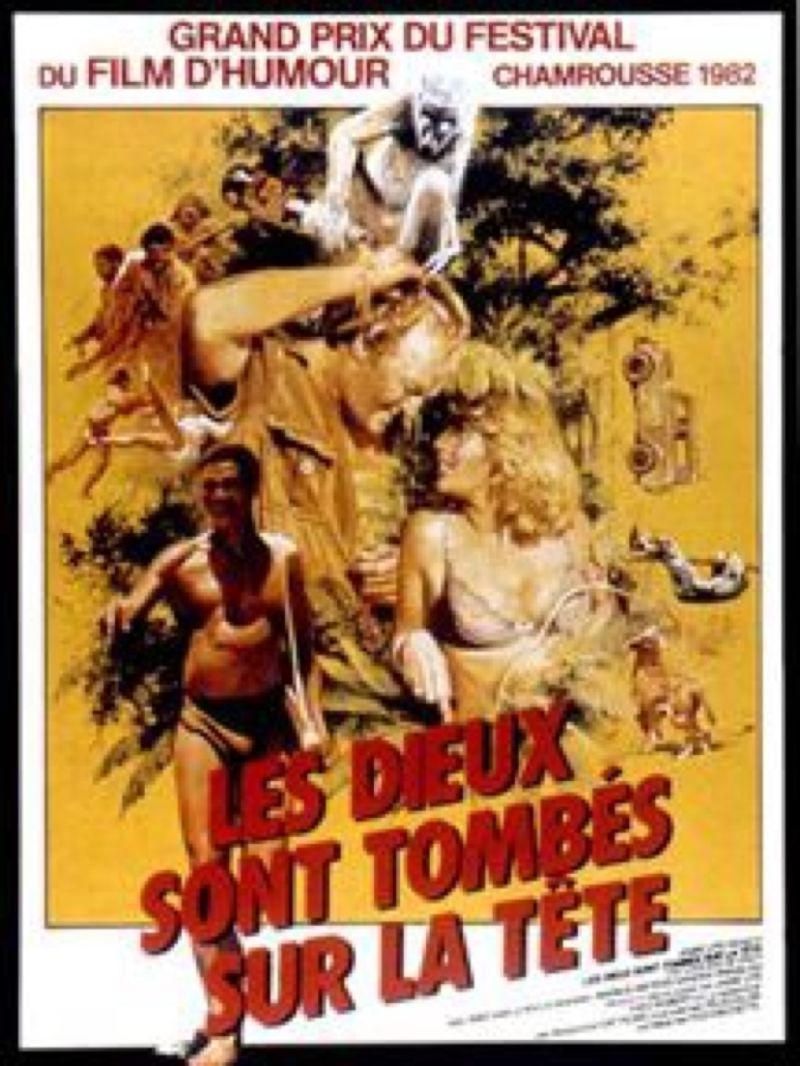

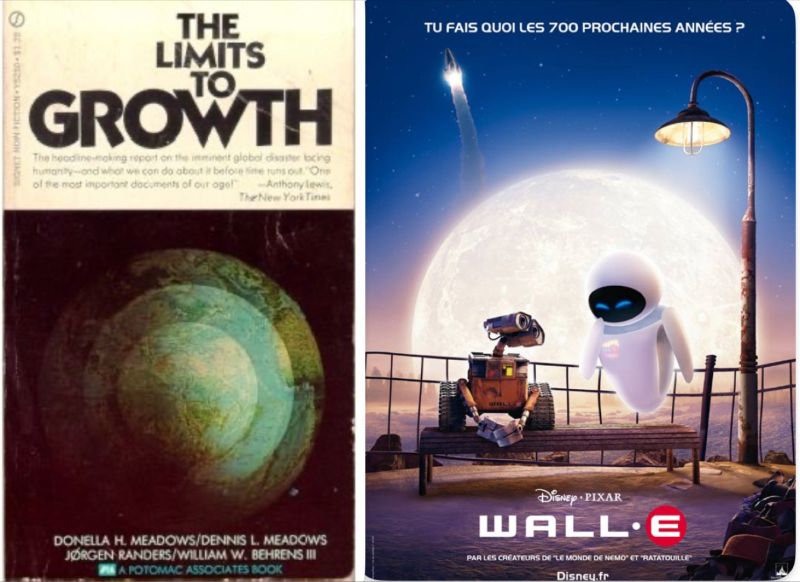


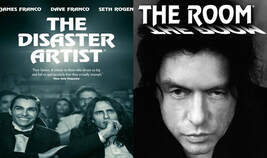

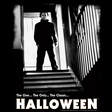
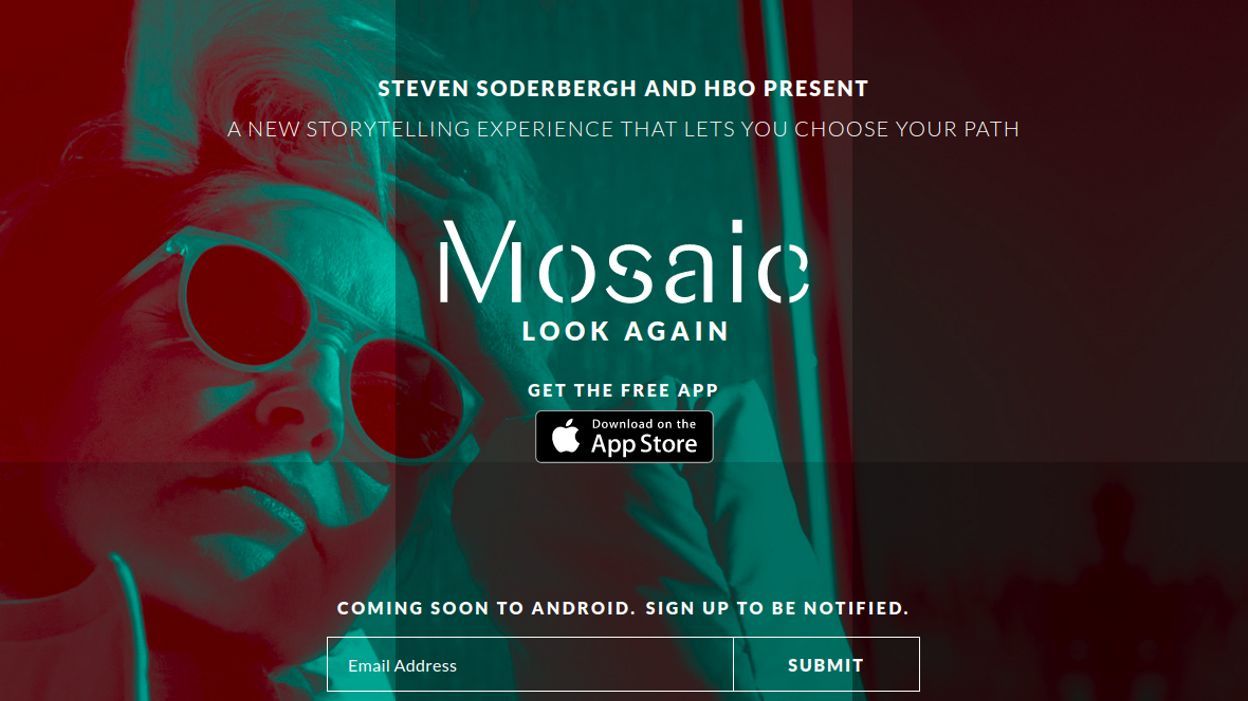



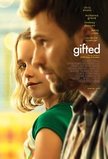
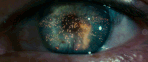


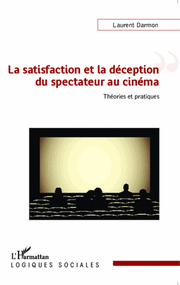
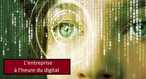
 Flux RSS
Flux RSS