
 Il arrive parfois que le spectateur s'étonne de retrouver la même intrigue - ou presque - servir les scénarios de deux films qui sortent quasiment simultanément. C'est souvent étonnant, parfois logique ... Un phénomène qui prend de l'ampleur avec la mondialisation et l'augmentation du nombre de films produits. En 2019, il y aura deux films pour évoquer l'assassinat de Sharon Tate, l'actrice et épouse de Roman Polanski : Il était une fois Hollywood de Quentin Tarantino et The hauting of Sharon Tate de Daniel Farrands. Pas un film de cinéma sur ce drame en un demi-siècle et voici deux films la même année produits aux Etats-Unis. Les traitements seront très différents mais la coïncidence est troublante. Avec plus de 500.000 films produits depuis 120 ans, les scénaristes et réalisateurs ont montré leur capacité à créer des oeuvres originales. C'est loin d'être évident avec un object fictionnel qui doit suivre des schémas récurrents pour satisfaire les attentes des spectateurs et créer de la dramatique. Ainsi la structure en trois actes est devenue la norme entre une présentation des personnages et du nœud de l'intrigue, puis un acte 2 centré sur la déclinaison de cette intrigue pour aller vers la résolution avec habituellement au moins un coup de théâtre qui relance la dynamique et enfin une dernière partie qui se concentre sur la résolution du problème du héros autour d'un climax. Cela permet à quelques théoriciens de proposer des recettes pour écrire un "bon" scénario, de John Truby à Robert McKee. George Martin a même identifié les 20 intrigues types que l'on retrouve habituellement dans les structures narratives des films :
 La Guerre des étoiles est entrée immédiatement dans l'histoire du cinéma, générant une communauté de fans qui fétichisent les objets du film. La saga a su dès sa sortie s'appuyer sur une affiche iconique, aux multiples influences, mais bien peu fidèle au film. Une histoire à rebondissements. Le merchandising n'est pas né avec Star wars malgré la légende. C'est Disney qui popularisa le concept des produits dérivés dans les années 30 autour du personnage de Mickey. Le cinéma live s'y mis bien plus tard : la série de films La planète des singes généra son lot de figurines aux Etats-Unis à la fin des années 60. En France, quelques années avant, on trouvait déjà des albums Thierry La fronde. Mais Star wars est bien le champion d'une activité marketing qu'il popularisera dès 1977 : les recettes des produits dérivés dépasseraient 25 Md$, soit nettement plus que celles des films eux-même. Cinéma oblige, ce sont les affiches du film qui ont été les grandes bénéficiaires de ce mouvement fétichiste. Ils sont nombreux les cinéphiles, ou pas, qui ont accroché un poster de Luke Skywalker. Et il y en a eu beaucoup, rien que pour le premier film. Le plus célèbre d'entre eux est l'affiche originale de la sortie de 1977 par l'affichiste Tom Jung, 35 ans à l'époque. Sa référence : Star wars "Style A". George Lucas choisit Tom Jung car il avait été marqué par l'affiche qu'il avait faite pour la ressortie en 1967 de Autant en emporte le vent (avec Howard Terpning). Rare exemple du poster d'une reprise qui a complètement effacé l'affiche d'origine. La pose romantique du couple Gable/Leigh fut d'ailleurs réutilisée en 1980 par Roger Castel pour l'affiche originale de L'Empire contre-attaque avec le masque noir de Vador à la place des flammes d'Atlanta. Jung était déjà un artiste établi puisque il était l'auteur des affiches originales de The Omen, L'homme qui voulut être roi, L'homme au pistolet d'or (James Bond), Papillon, Grand Prix et Docteur Jivago (ses œuvres ici).
 Le distributeur français a tout fait pour associer Lion à Slumdog millionaire, une référence qui écrase le film et son histoire "incroyable". Une facilité propre au marché français pour indexer le film dans un genre bien spécifique : le film "indien" à potentiel émotionnel pour le public occidental. Lion est un film qui plait beaucoup. En témoignent ses 6 nominations (non concrétisées) aux Oscars, son bon bouche-à-oreille au cinéma (-20% seulement en deuxième semaine en France) et ses bonnes notes attribuées un peu partout par le public : un rating de 9,4 sur 10 exceptionnel relevé par l'Observatoire de la satisfaction, une excellente note de 8,1 sur IMDb, un score élevé de 4,6 sur 5 par les internautes d'Allociné. Ce sont des évaluations extrêmement rares, atteintes par seulement une petite poignée de film par an. Mais ce n'est pas une oeuvre facile à vendre pour autant. Le distributeur a choisi de garder le titre original, court et énigmatique (on ne le comprend qu'à la toute fin). Australien, le film se passe en Inde pendant sa première moitié sans aucune star pour le porter avant l'apparition de Nicole Kidman après une heure de film. Les producteurs australiens ont d'ailleurs eu quelques difficultés à trouver un partenaire américain car les premiers approchés voulaient transférer l'intrigue d'Australie aux Etats-Unis. Or c'est l'adaptation d'une histoire vraie d'un garçon de cinq ans adopté en terre australe. Par respect pour la véracité de l'intrigue, ils ont refusé, rendant leur film moins "universel" pour le marché occidental. On peut le regretter, mais c'est une réalité économique difficile à contourner. La présence de Nicole Kidman, Rooney Mara et Dav Patel n'est pas anodine, mais pas suffisante pour porter le film, les deux premières ne jouant que des seconds rôles et Dav Patel n'ayant pas un pouvoir d'attraction réel au box-office.
 A côté de la Compétition officielle qui a sacré Moi, Daniel Blake, il y a le marché professionnel où producteurs et distributeurs font une grande partie de leur année. Difficile pour les films de se faire remarquer car les films doivent être vus pour être achetés. Le plus souvent. A Cannes, parallèlement au festival qui permet à des films d'être exposés au plus grand nombre, il y a une autre compétition au sein du Marché du film : il s'agit aussi d'attirer l'attention pour des films à la recherche d'un distributeur ou de la promotion la plus large possible.
Et là, tous les films ne jouent pas dans la même cours. En fait, il y a trois groupes. Les premiers, on les remarque facilement car ils occupent les emplacements les plus visibles, donc les plus chers, devant les grands hôtels de la Croisette. Cette année, Le Bon Gros Géant (très apprécié des festivaliers) et Star Trek sans limite (quelques images impressionnantes montrées à Cannes) étaient les mieux mis en avant. Ces films ne cherchent même plus à mettre leurs arguments en avant : ils affirment qu'ils seront bientôt là et ça suffit. Ainsi Disney fait l'impasse du nom de Steven Spielberg sur ses panneaux géants. On sait que le réalisateur du Pont des espions s'efface devant ses films pour ne pas leur voler la vedette (Cf. l'article ici). De mémoire de festivalier, il n'était jamais allé aussi loin, c'est-à-dire jusqu'à disparaître complètement. Ça fait longtemps que ces films sont déjà vendus à leurs distributeurs internationaux, mais il faut les persuader d'investir dans le marketing et en profiter pour avancer une communication institutionnelle pour le studio concerné qui a d'autres poulains cinématographiques à défendre. La Fox a cédé. Elle a décidé d’enlever une affiche du dernier film de la saga X-men qui était mal passée auprès de certains spectateurs. On y voyait le méchant du film agresser l’un des membres du groupe des super-héros de Marvel. Ce qui a choqué, c’est que le méchant en question est un mutant masculin qui étrangle un super-héros féminin avec le slogan « only the strong will survive ». L'affiche ne cherche qu'à créer un effet dramatique classique de héros face à une menace dangereuse. Mais quelques internautes avaient donc montré leur colère de voir une femme ainsi maltraitée avec une phrase justifiant cet acte odieux. C’est à leurs yeux une justification de la violence faite aux femmes, voir une incitation liée à cette phrase dérivée de la théorie darwinienne.
C’est ce qui est gênant dans l’interprétation qui est faite ici. En effet, le personnage se caractérise justement par sa dévotion au principe darwinien qui le pousse à supprimer les faibles. Si une telle caractéristique s’explique facilement dans un comics ou un film, c’est plus difficile par une image figée sur une affiche. D’où l’utilisation d'un personnage à la posture dominante face à l'x-men apparemment le plus chétif (et de fait à l’actrice la plus connue du film). Le slogan « seuls les plus forts survivent » (en français, on passe au pluriel) n’est donc que la reprise d’un principe du personnage qui existe depuis sa création dans les comics en 1986. Attaquer l’affiche revient à la fois à se révolter contre la métaphore « sexe faible » liée au péché originel d’Eve cédant à la tentation et au principe de sélection naturelle qui donne plus de chance de se perpétuer aux êtres qui ont un caractère avantageux. Et le problème est là : associer maladroitement une expression devenue sexiste (« sexe faible ») à la formulation reprise en slogan crée de fait une interprétation certes involontaire, mais inopportune pour qui voit là une guerre des sexes où la violence faite aux femmes par les hommes trouverait une explication « naturelle ».  Au moment où l'épisode 7 sort en blu-ray, la première trilogie de La guerre des étoiles est à nouveau annoncée dans les salles américaines pour août prochain. Les fans cinéphiles se réjouissent de retrouver "leur" film... ou pas. L'annonce anime la grande communauté des fans de l'univers de La guerre des étoiles. L'opportunité est offerte d'apprécier les trois films de 1977, 1980 et 1983 sur grand écran. En tout cas, pour les américains qui auront droit à une exploitation dans 20 grandes villes (San Francisco, Washington, Los Angeles, New-York, Miami, Dallas, Austin, Boston et Philadelphie sont déjà annoncées si vous préparez vos vacances). Ce n'est pas une reprise d'envergure et pour le moment ce n'est prévu que pour les Etats-Unis du 6 au 27 août. Déjà les fans discutent de la version qui sera projetée : montage original, édition spéciale (1997) ou celle revue depuis pour le DVD (2004) ? Car il existe de nombreuses versions. Bien sûr beaucoup connaissent l'histoire de ces "corrections" qui ont permis à George Lucas de revoir ses films pour les compléter comme il les rêvait (plus de monstres, rajout de Jabba the Hunt, révision des couleurs...). On sait moins que les films ont continué à être modifiés en 2011 au moment de la sortie du Blu-ray (rocher devant R2D2, couleur du sabre laser...). Ou que certains pays avaient déjà fait des ajustements dès la sortie (en Allemagne sur la scène de torture de l'épisode 2 pour l'autoriser aux plus de six ans) et que la version Laserdisc du début des années 90 a aussi subi quelques modifications (raccourcissements non assumées car il y a eu repressage avec rajout des 7 secondes retirées peu après). Dès 1981, il y avait eu un changement d’envergure : d'épisode initial, La guerre des étoiles devenait Un nouvel espoir, (a new hope en vo) proposant aux futures générations d'être vu en quatrième. C'est capital puisque le coup de théâtre familial de la fin de L'Empire contre-attaque perd de sa substance lorsque le spectateur voit d'abord les films de la deuxième trilogie.
 Une affiche est faite pour donner envie et ce n'est pas si évident. Surtout quand une vingtaine de films sont en concurrence chaque semaine. C'est pour ça que la promotion utilise souvent des citations de journalistes qui ont aimé le film pour tenter de convaincre les spectateurs. Ces critiques sont toujours élogieuses ? Cela s'avère parfois plus compliqué que ça, entre ironie, mauvaise foi et créativité. Les distributeurs savent que le spectateur se déplace s'il est confiant dans une qualité élevée. La qualité attendue active son intention de voir un film et le rapport entre les risques de déception et les bénéfices attendus stimule son comportement à transformer un désir en action. Une critique positive est donc un atout tant pour jouer sur l'évaluation a priori que sur la légitimité du film, et donc indirectement les bénéfices attendus. Cela fonctionne surtout quand le critique est crédible (ce qui est moins le cas pour les films grand public) et lorsque l'effet de légitimité fonctionne (également peu pertinent pour les blockbusters). Néanmoins une critique positive fait rarement du mal et les distributeurs n'hésitent donc pas à les mettre en avant. Il est intéressant de se pencher sur le cas des films qui ont utilisé des critiques négatives. Plusieurs cas peuvent être observés et la plupart d'entre eux sont surprenants :
 On a beau être le réalisateur le plus connu du cinéma (10 Md$ de recettes monde au cinéma), il arrive parfois que l'on préfère garder une certaine retenue. Cela complexifie quelque peu le travail de ceux qui doivent faire la promotion de ses films. Les acteurs tiennent à ce que les affichent les mettent bien évidence. Une façon pour eux de se promouvoir autant que le film. La polémique à propos d'Un moment d'égarement est venue récemment nous le rappeler. Mais il y a des auteurs qui au contraire cherchent à ne pas faire d'ombre au film pour que celui-ci puisse exister comme une singularité. Ainsi Woody Allen impose-t-il depuis sa mésaventure de Quoi de neuf pussycat ? de maîtriser totalement ses films. Cela dépasse même le film lui-même : le comique new-yorkais tient immuablement à ce que les acteurs principaux soient cités dans l'ordre alphabétique, au refus des bonus sur les DVD/Blu-ray et à ce que son nom soit un argument de vente sur les affiches. Une sobriété qui a pour but de ne mettre que le film en avant Steven Spielberg, à l'instar de Woody Allen, tient à garder le contrôle de ses films. Il formalise aussi dans ses contrats la taille de son nom sur les affiches pour qu'il ne devienne pas une marque. De fait, ce n'est pas facile pour le distributeur de "vendre" le dernier Spielberg lorsqu'on ne peut pas rendre clairement visible le nom du réalisateur sur des affiches surchargées d'images, de slogan et parfois du nom des acteurs. On ne s'étonne donc pas de retrouver le nom des acteurs vedettes en haut de l'affiche et de devoir s'amuser à chercher où est écrit celui de son metteur en scène.
Sur un environnement culinaire similaire à A vif qui sort cette semaine, le film #Chef n'a pas marché en salles dans le monde même s'il a assuré le minimum aux États-Unis. Sorti en début d'année, il s'agit pourtant d'un fell-good movie dans la tradition du genre. On lui reprochera juste son affiche qui n'hésite pas à dévoiler comment le film finit. Le but de la promotion est bien de faire venir le spectateur en salles, pas vraiment de le satisfaire.  Les distributeurs ont un dur métier. Ils doivent chercher à donner envie tout en ne dévoilant pas trop le contenu du film. La satisfaction se construit notamment grâce à l'effet de surprise. Cette construction de la satisfaction est fondée sur la divergence par rapport au schéma (Rumelhart, 1984 [1]). Or cette divergence disparait lorsque le spectateur sait déjà à quoi s'attendre, qu'il n'y a plus de surprise, facteur d'excitation positive. Or le spectateur a besoin d'en savoir un minimum pour indexer un film et pouvoir appréhender son attente. Si cette attente est élevée, elle pourra activer du désir et donc l'action d'aller voir le film. Sans une attente élevée, le spectateur préfèrera rester chez lui ou voir un autre film. C'est pourquoi les bande-annonces ont tendance à s'allonger pour permettre au spectateur de mieux appréhender à la fois le caractère spectaculaire (un film est un spectacle qui joue sur les effets) et le caractère narratif (un film est une intrigue dans laquelle on se projette). Au risque d'en dire trop comme dans le trailer américain de Seul au monde qui annonce si le héros va s'en sortir ou non. Le film #Chef a posé le problème à son distributeur. Le film évoque les difficultés d'un cuisinier renommé à quitter la routine confortable de son menu quotidien à succès pour retrouver l'authenticité de sa cuisine, et au passage une relation avec son fils et sa femme. C'est en fait un fell-good movie comparable à Little Miss Sunshine dont il reprend indirectement la construction classique en road movie qui permet aux personnages de révéler leur vraie nature (comme souvent, la proximité entre les deux films est soulignée par le choix de la couleur, jaune en l’occurrence, et la mise en évidence d'un camion/camionnette). Le distributeur n'a donc pas voulu rester sur la première partie du film évoquant le personnage en crise pour au contraire le montrer retrouvant sa joie de vivre. Il apparait donc souriant dans un food-truck en compagnie de sa famille, son ex-femme et son fils.  L'affiche du film français, Un moment d'égarement (2015), a créé une petite polémique récemment sous l'impulsion de l'actrice Frédérique Bel (ex-blonde de Canal+) car le nom des deux actrices principales n'était pas repris sur l'affiche contrairement à celui des deux comédiens masculins : "ils ont aussi égaré le nom des actrices ?" avait-elle ironiquement demandé sur Twitter. Il n'en a pas fallu d'avantage pour entendre des accusations de sexisme. Nous ne rentrerons pas dans le débat de savoir si la société ou le monde du cinéma est sexiste, sans pour autant minimiser l'importance de l'enjeu sous-jacent. En revanche, nous nous étonnons de voir une telle polémique alors qu'une affiche est construite selon trois principes :
 Un film est par essence un produit unique qui se doit d'être original, mais qui s'inscrit en même temps dans des schémas connus pour être correctement interprété. Le genre est un marqueur qui va permettre au public d'appréhender rapidement le film. Lorsque le film se présente au spectateur, il est accompagné d’un discours qui le positionne dans une catégorie générique. C’est un western, une comédie, un thriller. Le genre apparaît comme une référence entre ceux qui font le film et ceux qui sont appelés à le voir. |
Docteur en Sciences de l'information et de la communication, Laurent Darmon est devenu par cinéphilie un spécialiste de la réception cinématographique et de la sociologie du cinéma.
Il est l'auteur d'une thèse sur "l'itinéraire de l'évaluation d'un film par le spectateur au cinéma", anime des conférences et a été le Président de la Commission Cinécole 2016. Parallèlement, il est en charge du digital dans une grande banque française.
|





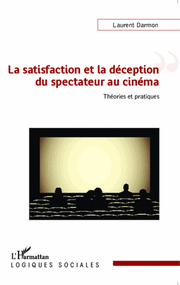

 Flux RSS
Flux RSS

