
 Première année est un film sur deux parcours étudiants au sein d'une université de médecine, réalisé par un ancien médecin devenu réalisateur. Entre docu-fiction et fiction documenté, Thomas Lilti a choisi principalement le camp du cinéma. Un choix qui l'amène à choisir entre décrire la réalité ou raconter une histoire. Un choix qui a divisé quelques spectateurs. Le cinéma est là pour raconter des histoire. mais pour toucher au coeur son public, certains chemins sont plus efficaces. Il faut d'abord parler du spectateur pour l'impliquer et lui permettre de ressentir ce qu'il voit à l'écran dans un mouvement sympathique ("ressentir avec"). Mais il faut aussi l'amener à découvrir des choses différentes de son quotidien pour remplir son objectif de divertissement. Si le cinéma est un moyen d'évasion, il faut bien que le cinéma projette au spectateur un lieu ou des faits qui l'amènent autre part que son traditionnel "métro, boulot, dodo". Entre parler de son soi et surtout ne pas parler de chez soi, le réalisateur doit construire une fiction intime. Lorsque James Cameron évoque le naufrage du Titanic, il raconte une histoire universelle où le riche et le pauvre, homme et femme, peuvent s'identifier. Lorsque Marvel conte une aventure de super-héros, le studio prend bien soin d'attacher des faiblesses psychologiques à son héros que chacun a pu déjà expérimenter. En tournant Première année, son troisième film sur le milieu des médecins, le réalisateur Thomas Lilti a été confronté à cette opposition de raconter une histoire originale et de faire passer des émotions connues du plus grand nombre. Et comme au cinéma, on privilégie toujours l'image aux mots, il a fait des choix dans ce sens. Parfois en ajustant la réalité quand cela pouvait conforter son propos.

Le plan débullé est une figure de style de la réalisation d'un plan qui s'est imposée assez tôt dans l'histoire de la mise en scène cinématographique. Son sens est multiple et se conçoit par opposition avec un plan filmé de façon classique.
Les règles de cadrage suivent un principe de respect de la réalité. Le plan filmé cherche couramment à représenter ce qu'un témoin invisible verrait s'il observait la scène. Il y a donc un souci de réalisme à reproduire ce que l’œil voit. Or, l’œil humain voit le monde selon un plan à l'horizon invariablement horizontal, même si on penche la tête. Mais le plan cinématographique est appelé à transmettre des sensations nouvelles et le plan débullé participe à traduire certains effets perceptifs.
Le plan débullé, aussi appelé parfois plan cassé, plan penché ou Dutch angle en anglais, consiste à déplacer de quelques degrés l'inclinaison de la caméra afin de désolidariser le bas du cadre et la ligne d'horizon. Cet effet peut être accentué de deux façons. Soit en forçant sur cette inclinaison pour se rapprocher des 45°, soit en plaçant dans le plan une ligne de fuite traditionnellement horizontale mais dont l'inclinaison apparaît nettement au spectateur.

Les miroirs sont souvent là pour éclairer la personnalité des personnages, exacerbant les stéréotypes sexistes qui ont la vie dure au cinéma. Illustration en image à travers une compilation de films mettant leur héros devant ses contradictions.
Si le cinéma est plus fort que la vie, il tente souvent d'amplifier des tendances observées par les cinéastes. C'est pourquoi il existe une sociologie du cinéma qui permet d'éclairer les faits de société sousjacents. C'est ainsi que Siegfried Kracauer illustra les tourments de l'âme germanique en observant les films de l’expressionnisme allemand dans son livre De Calligari à Hitler.
Pour qui le cinéma est un art édifiant, il est donc intéressant d'examiner les stéréotypes portés par le cinéma d'aujourd'hui. Les films ont souvent joué avec le reflet dans les miroirs (on en dénombre 190 ici). Le miroir a depuis longtemps été objet de fascination, permettant à Alice d'aller au Pays des merveilles. C'est devant son miroir que le Travis de Taxi driver montre sa folie qui le démange ("You talkin’ to me?").
Les femmes pleurent et les hommes se mettent en colère lorsqu'ils sont confrontés à eux-mêmes devant une glace. Les unes sont vulnérables et émotives quand les autres sont colériques et puissants. Voilà ce que l'on peut tirer comme conclusion sexiste en regardant des films. C'est du moins la lecture évidente de cette compilation de Joost Broeren, un monteur néerlandais, qui en tire une amusante infographie.
 Parmi les vedettes du cinéma français, Jean Dujardin a un forte côte d'amour auprès des spectateurs. Il a su transférer sa notoriété de la télévision au cinéma, en élargissant même ses rôles au-delà de la franche comédie. Pourtant, Un homme à la hauteur n'a pas atteint le score attendu malgré un casting, un sujet et une réalisation qui contenaient apparemment tout ce qu'il faut pour faire un succès. Jean Dujardin est un acteur populaire dans le plus beau sens du terme. Il fait un cinéma que les spectateurs aiment voir : des comédies burlesques, des comédies, des comédies romantiques, des comédies policières et mêmes des thrillers purs et durs. A chaque fois le public suit. Il a titillé le sommet avec Brice de Nice qui l'a imposé au cinéma à partir d'un personnage créé pour la télévision (avec les Nous ç nous) et depuis, il n'a jamais déçu permettant à des films pas si simples (Le bruit des glaçons, Un balcon sur la mer, Möbius) de rencontrer des succès tout à fait convenables. Et tout semblait bien parti pour Un homme à la hauteur. L'acteur avait enchaîné 5 films à plus de un million de spectateurs avant d'approcher ce seuil avec Un + une, le dernier Claude Lelouch qui n'avait pourtant plus atteint ce score depuis vingt ans. Sa partenaire, Virginie Efira, avait montré sa capacité à porter un film avec 20 ans d'écart (1.400.000 spectateurs). Quant au réalisateur, Laurent Tirard, c'est devenu une valeur sûre du cinéma français, capable de transposer avec talent l'univers de René Gosciny dans le très réussi Le petit Nicolas ou de ramener les français voir Molière au cinéma (1.200.000 spectateurs). Reste enfin, le film lui-même. C'est une comédie romantique grand public à concept. Un bon point pour attirer les foules dans un genre qui n'a rien à envier à L'arnacœur (3,8 Millions) ou Hors de Prix (2,1 M). Et pour couronner le tout, le film est réussi : les dialogues sont sympathiques, les acteurs font le job, la mise en scène apporte du rythme et les situations leur part d'originalité convenablement balisée. Le concept avait été testé avec succès puisque c'est le remake - à l'intrigue similaire à l'original argentin d'ailleurs - du film Corazon de Leon qui avait très bien marché en Argentine. Rien à dire et le public s'est dit globalement satisfait : 3,4 (sur 5) sur Allociné, la troisième meilleure performance des films avec Jean Dujardin en rôle principal. Et pourtant.

Surprendre le spectateur en lui assurant de trouver ce qu'il vient chercher. Voila le Graal de tout producteur qui se lance dans un film pour lequel le public a des attentes fortes. Et comme le public est hétérogène, il n'y a rien d'évident pour résoudre cette apparente contradiction de la production cinématographique. Illustrations de solution avec trois exemples.
Lorsqu'on se lance dans la production d'une adaptation du Petit prince, il y a une évidence : ne pas décevoir les fans du roman de Saint-Saint-Exupéry d'autant que le livre comprend des aquarelles de l'auteur présentes dès l'édition originale de 1943 et qui ont forgé l'imaginaire des lecteurs. Avec plus de 45 millions de livres vendus dont un quart en France, c'est le plus gros succès de l'édition après la Bible ! Il en découle des devoirs de respect de l'oeuvre originale. Mais de nombreux spectateurs ne voient pas l'intérêt non plus d'aller voir une histoire qu'ils connaissent et qui justement a déjà été imagée dans leur imagination grâce à ces aquarelles. Il faut donc apporter du neuf sans trahir la matière d'origine désormais sacralisée.
C'est l'approche que le réalisateur du dessin animé sorti en 2015, Mark Osborne, a défendu pour raconter une histoire qui se dédouble : "Quand on m’a proposé ce projet la première fois, j’ai refusé car il me semblait impossible d’adapter un livre aussi iconique. Il y a autant d’interprétations que de lecteurs, ce qui complique la tâche. Et puis, j’ai réfléchi : il ne fallait pas faire une adaptation classique mais raconter justement le sentiment que l’on peut avoir à la lecture. C’est comme ça qu’est née l’histoire de la petite fille qui se dessine en parallèle de celle du Petit Prince : totalement nouvelle, elle m’offre l’espace de liberté qui me permet de garder intact le roman et de protéger les émotions qu’il véhicule. Tous les artisans qui ont travaillé sur ce film ont d’ailleurs suivi au pied de la lettre les mots de l’aviateur dans le livre : "Je ne veux pas que mon histoire soit prise à la légère."
La solution technique retenue est astucieuse. Composer le film avec une partie imaginaire en stop motion en respectant la texture du papier et un monde réel en numérique 3D conforme à la norme Pixar.

Dans une récente vidéo parodique, l'anglais Paul Taylor se moque du cinéma français. Il s'attaque à ses critiques, ses succès et à ses clichés. C'est cruel car tous les cinémas du monde ont leurs clichés qui sont autant de repères d'une culture commune de ceux qui font les films et ceux qui les regardent.
Les discussions de trentenaires autour d'un café, une scène de réveil au lit à deux, la pluie derrière les vitres, les appartements parisiens de plus de 100 m2 à Paris, la quête de sens dans une société compliquée. Le cinéma français aime afficher sa différence dans les stéréotypes. Résultat, il existe même un mot-clé pour jouer avec ces situations récurrentes : #CommeDansUnFilmFrançais. Il faut reconnaître pourtant que ce sont les américains qui sont les plus caricaturaux pour représenter la France : tous les appartements ont une vue sur la Tour Eiffel, l'accordéon accompagne la musique, tout le monde roule en Renault ou Citroën, la vie à la campagne ressemble à celle de Pagnol, le parisien combine chic, alcool et cigarette tandis que baguette et béret sont encore souvent de rigueur.
 Plus grand cinéma d'Europe, le Grand Rex est l'un des derniers palaces d'une époque où le cinéma se consommait autrement. Un anachronisme dans l'univers du cinéma d'aujourd'hui. Le Grand Rex est né dans les années 30. Il s'agissait alors d'offrir un spectacle total qui puisse rivaliser avec le théâtre. En effet, l'avènement du parlant avait fait entrer le cinéma dans une nouvelle phase plus réaliste. Si la mise en scène s'autonomisait de plus en plus par rapport au théâtre, la sonorisation en rapprocher la narration.
Son concurrent parisien s'appelle alors le Gaumont-Palace qui ouvre en octobre 1911, mais qui sera revu entièrement sur les nouveaux standards de l'époque en 1931. C'est cette initiative de Léon Gaumont qui pousse à son tour le distributeur Jacques Haïk à investir dans son palace cinématographique. Il rachète des terrains Boulevard Poissonière et confit la construction du bâtiment à l'architecte Auguste Bluyssen, à qui l'on doit déjà la plus part des belles salles parisienne d'alors et quelques casinos. Le maître d'oeuvre est Georges Tombu, un constructeur important de l'époque. Il est aidé pour la conception de la salle de l'ingénieur américain John Eberson qui officie dans les cinémas des Etats-Unis depuis 1905 (on lui doit en tout près de 100 salles dont le Majectic à Houston qui marque son style des "cinémas d'atmosphères", c'est-à-dire donnant l'impression d'être à l'air libre). Dans un style art déco typique de l'époque, ils s'inspirent du Radio City hall de New-York : même estrade, embrasure arrondi autour de la scène, disposition des trois niveaux et ambiance générale. Pendant les travaux, on creusa si profond qu'on trouva quelques vestiges du vieux Paris : pièces anciennes, ossements, murailles ancienne...  Pendant longtemps, le cinéma n'avait pas vraiment d'égal pour apprécier un film dans de bonnes conditions. Contre le grand écran et un son enveloppant, la télévision ne pouvait rivaliser. Les temps ont changé et un petit bilan des forces en présence s'impose en analysant la technique et la qualité de l'expérience. “Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse.” (Jean-Luc Godard) Depuis que cette déclaration de l'auteur d'A bout de souffle, le rapport entre cinéma et télévision a bien évoluer.
Tout d'abord, la télévision a changé. Outre l'évolution du matériel qui a vu l'épaisseur de son écran fondre alors que les tailles des diagonales augmentaient, la façon de la regarder a été profondément modifiée par la délinéarisation apportée d'abord par la télévision de rattrapage, puis par des innovations du type Molotov.tv. Le cinéma n'est pas en reste car il a fallu répondre à ce renforcement de ce concurrent historique et des nouveaux loisirs numériques L'exploitation en salles est pourtant un domaine relativement conservateur car les investissements sont importants, les échecs fréquents [1] et il faut souvent que l'ensemble de la chaîne, de la production à la distribution, évolue parallèlement. Mais, pour survivre, ce conservatisme a été oublié ces dernières années. Ainsi, le cinéma numérique a totalement remplacé la pellicule et le spectacle en 3D est devenu l'apanage de la salle au regard d'un adoption finalement timorée sur le petit écran. Les évolutions les plus notables sont néanmoins dans la salle de cinéma où le confort a significativement progressé. De fait, de nombreuses salles devenues inadaptées face à la concurrence ferment mais de nouvelles plus modernes se créent. A Paris, Ce sont Le Gaumont Mistral, La Pagode et récemment le Gaumont Ambassade qui ont fermé définitivement leurs portent quand le Pathé Beaugrenelle et bientôt le Pathé Vilette renforcent l'offre cinématographique des parisiens. Les rénovations sont nombreuses avec des espaces plus adaptés à la sociabilité (café, librairie, restauration...). Même les salles destinées aux cinéphiles se refont une beauté à l'image du Trois Luxembourg. A chaque fois, la technique est remise au gout du jour : 4K, Atmos, 3D. Et des expérimentations sont faites pour proposer des fauteuils bougeants et des cinémas de réalité virtuelle. On annonce aussi des projecteurs à l'image plus lumineuse et le retour des écrans panoramiques XXL. Vivement demain. 
Après le parlant, la couleur et le relief, le cinéma cherche toujours à créer le plus d’immersion possible. La réalité virtuelle s'intègre parfaitement dans cette trajectoire. De la science-fiction, nous sommes déjà en train de nous y plonger. Reste à confirmer.
Qu'on s'imagine en train de regarder le prochain Star wars immergé totalement sur Tatooine ou au bord du Faucon Millenium. On peut tourner la tête tranquilement pour suivre une dispute entre Rey et Poe Dameron. Aucun rappel des limites de l'écran de projection, aucune gène de la tête du spectateur de devant et encore moins d'énervement à sentir la lumière verte du panneau "sortie" au dessus d'une porte dérobée. Que le plaisir de suivre les plans toujours centrés par le réalisateurs mais avec cette liberté d'être enfin vraiment ce fameux témoin invisible que veut nous faire croire que nous sommes le cinéma depuis 120 ans.
C'est déjà presque une réalité pour ceux qui ont pu mettre sur leur tête ces casques qui font le bonheur des geek depuis un an. Mais il s'agit souvent de démonstration de visites virtuelles ou de petits films faits à la va-vite par des techniciens en apprentissage de cette nouvelle grammaire visuelle qui rappelle dans leur démarche les opérateurs du cinématographe des frères Lumière.
LoVR from Aaron Bradbury on Vimeo.
On voit néanmoins apparaître des premiers films plus ambitieux à l'image de Sonar qui permet de voyager dans l'espace à bord d'un drome ou Lovr, cette approche expérimentale d'une rencontre amoureuse suivie sur une ligne du temps reproduisant l'activité neurologique de "elle" et "lui" (à voir ci-dessous, mais c'est fait pour se balader visuellement.dedans). Il existe aussi la possibilité de voir le spectacle musical du Roi Lion au milieu de la scène avec les danseurs/chanteurs à ses côtés.
 Sorti il y a tout juste un mois dans la quasi-indifférence, Demolition, le dernier film du québécois Jean-Marc Vallée a divisé les critiques et les spectateurs. Il faut croire que ces deux publics ne sont pas venus y trouver la même chose. Comment en sommes-nous arrivés à cette dichotomie de point de vue face au même film, un film sur un thème fédérateur à défaut de générer du bonheur. Attention spoiler. Tout d'abord, je dois dire que j'ai aimé Démolition. Je ne savais rien du film, du moins de son histoire lorsque je suis entré dans la salle. J'avais juste vérifié que sa note sur IMDb "valait le coup" : 7,5, c'est plus que 7, seuil au dessus duquel je m'intéresse au film avec bienveillance (au-dessus de 8, j'y vais avec motivation les yeux fermés alors qu'en dessous de 6 je fuis habituellement en courant). Et je n'avais pu empêcher un bon ami de me prévenir avec insistance que les critiques reprochaient juste au film sa fin maladroite. En revanche, je n'avais aucune idée du thème de Demolition. Devant le cinéma, je n'avais que l'affiche pour me guider. Avec un titre pareil (en majuscule sans accent, on lit potentiellement le titre avec l'accent yankee) et une telle affiche (montrant un Jake Gyllenhaal avec un faux air d'Indiana Jones à lunettes noires), on pourrait facilement s'attendre à un petit thriller indépendant. D'autant que le simili papier craquelé de l'affiche tend à faire croire que "ça va déchirer". Le nom du film n'est pas sans rappeler non plus un vieux action movie de Sylvester Stallone des années 90. Bref beaucoup de fausses pistes...
 La sortie en vidéo aujourd'hui de Connasse, princesse des cœurs, performance conceptuelle inspirée par la télévision, remet en perspective le lien entre fiction et réalité. Un thème couramment travaillé par le cinéma pour mieux emmener le spectateur de l'autre côté du miroir. Pour regarder un film avec bienveillance, le spectateur doit chercher à croire à ce qu'il voit. Mais au cinéma, les choses ne se déroulent pas comme dans la vraie vie. Il doit donc se mettre en situation d'époché (c'est-à-dire se libérer du jugement de la réalité pour entrer dans la fiction). C'est ainsi qu'en voyant un film policier, le public accepte l'idée que les forces de l'ordre puissent tirer dans la foule. C'est l'art de la narration de construire une histoire qui permette l'épochè.
On observe également que la forme peut paradoxalement contribuer à cette suspension de l'incrédulité. En rapprochant l'expérience cinématographique d'un sentiment de réalité, on aide le spectateur à se projeter. Le cinéma 3D participe au mouvement et son semi-échec - ou semi-succès - tient à l'obligation de porter des lunettes qui apportent un nouvel élément artificiel en substitution, matériel cette fois. Alors la façon de filmer est mise à contribution. Avec le found footage, la caméra filme en vue subjective en cherchant à reproduire la forme du cinéma amateur. Il s'agit de faire vrai. Le mockumentaire, documenteur ou faux documentaire, va dans le même sens en reproduisant la forme du documentaire pour raconter ou décrire une intrigue ou une communauté.  Le contexte de la projection comme le choix de la salle joue un rôle important dans la façon dont le spectateur perçoit le film qu'il regarde. Une expérience dans le métro illustre parfaitement ce phénomène. Les conditions de la projection influencent significativement la perception d'un film. La taille de l’écran et de la salle sont, avec la qualité de la projection, les éléments plébiscités par plus de 94% des spectateurs, devançant l’accueil, le nombre de films proposés ou les conditions d’attente [1]. La projection en 3D exalte également l’aspect événementiel du cinéma. Assez naturellement, les conditions de projection influent directement sur la capacité d’immersion du film. Ainsi le contexte de diffusion impacte-t-il directement la satisfaction car il constitue l’une des composantes de l’expérience cinématographique. Mais, plus symptomatique, il influence également directement la perception du film, autre composante essentielle de cette expérience. L’expérience du Washington Post le 12 janvier 2007 avec Joshua Bell dans un métro américain à l’heure de pointe montre l’importance du canal de diffusion du film. Le violoniste, de réputation mondiale, joue pendant 45 minutes son stradivarius icognito dans la quasi-indifférence de centaines de passants. Sept personnes se sont arrétées sur 1032 qui sont passées devant lui. La dernière d'entre elles est restée plus longtemps et s'en explique à la fin de la vidéo : elle l'a reconnu pour l'avoir vu jouer justement quelques jours plus tôt.
Cette expérience démontrait le poids de la mise en scène et de la mise en situation pour légitimer et reconnaître la valeur de l’art. Un tel phénomène est illustré au cinéma par la foule qui se presse à la projection officielle cannoise de quelques films étrangers qui sortiront quelques semaines plus tard dans l’indifférence quasi-générale, y compris de l’intelligentsia. [1] - CNC, dossier n°331, La géographie du cinéma, septembre 2014 |
Docteur en Sciences de l'information et de la communication, Laurent Darmon est devenu par cinéphilie un spécialiste de la réception cinématographique et de la sociologie du cinéma.
Il est l'auteur d'une thèse sur "l'itinéraire de l'évaluation d'un film par le spectateur au cinéma", anime des conférences et a été le Président de la Commission Cinécole 2016. Parallèlement, il est en charge du digital dans une grande banque française.
|



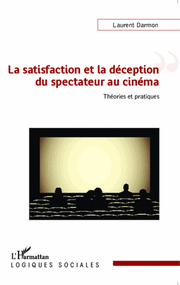

 Flux RSS
Flux RSS

