
 Il arrive parfois que le spectateur s'étonne de retrouver la même intrigue - ou presque - servir les scénarios de deux films qui sortent quasiment simultanément. C'est souvent étonnant, parfois logique ... Un phénomène qui prend de l'ampleur avec la mondialisation et l'augmentation du nombre de films produits. En 2019, il y aura deux films pour évoquer l'assassinat de Sharon Tate, l'actrice et épouse de Roman Polanski : Il était une fois Hollywood de Quentin Tarantino et The hauting of Sharon Tate de Daniel Farrands. Pas un film de cinéma sur ce drame en un demi-siècle et voici deux films la même année produits aux Etats-Unis. Les traitements seront très différents mais la coïncidence est troublante. Avec plus de 500.000 films produits depuis 120 ans, les scénaristes et réalisateurs ont montré leur capacité à créer des oeuvres originales. C'est loin d'être évident avec un object fictionnel qui doit suivre des schémas récurrents pour satisfaire les attentes des spectateurs et créer de la dramatique. Ainsi la structure en trois actes est devenue la norme entre une présentation des personnages et du nœud de l'intrigue, puis un acte 2 centré sur la déclinaison de cette intrigue pour aller vers la résolution avec habituellement au moins un coup de théâtre qui relance la dynamique et enfin une dernière partie qui se concentre sur la résolution du problème du héros autour d'un climax. Cela permet à quelques théoriciens de proposer des recettes pour écrire un "bon" scénario, de John Truby à Robert McKee. George Martin a même identifié les 20 intrigues types que l'on retrouve habituellement dans les structures narratives des films :
Les plus jeunes découvrent les films dans un environnement distinct de celui de leurs aînés : expériences cinéphiliques différentes, proposition de films enrichie, habitudes générationnelles etc. A chaque génération, il faut réimaginer ce qu'un film signifie pour ses nouveaux spectateurs. La Saga de George Lucas est à ce titre un cas d'école. Star Wars a imposé sa mythologie à travers la richesse de son univers, la cohérence des histoires et la symbolique de ses personnages. Cette richesse offre finalement de multiples portes d'entrée entre préquel, séquel, spin-off et univers étendu. Il y a des grandes questions qui obsèdent les fans de cinéma et pour lesquelles il serait vain de chercher à apporter des réponses. La toupie d'Inception s'arrête-t-elle de tourner ? Deckard est-il un réplicant dans Blade Runner ? Que dit Bill Murray à l'oreille de Scarlett Johansson à la fin de Lost in translation ? En fait, ces questions perdurent dans la mythologie cinéphilique parce qu'il n'y a pas de réponse évidente. Même lorsque Ridley Scott apporte une réponse pour Blade Runner ("c'est un replicant"), les spectateurs ne sont pas convaincus (et Harrison Ford non plus). Dans quel ordre voir les films Star Wars fait partie de ces questions qu'il serait vain de trancher tant les arguments peuvent s'opposer. Et là encore, l'avis de George Lucas qui privilégie l'ordre chronologique n'a pas plus de valeur que celui d'autres spectateurs puisqu'en offrant ses films dans l'espace public, son créateur laisse chaque spectateur en faire ce qu'il veut. Le public a autant de droit à poser sa propre appréciation que de définir la carrière de spectateur idéal pour voir les films de la série La Guerre des Etoiles. C'est pourquoi la façon la plus naturelle d'un spectateur de répondre à cette question sur l'ordre de visionnage idéal revient souvent à se reporter à sa propre expérience. Ceux qui ont connu la sortie des films depuis la première trilogie (77/80/83) avant la prélogie (99/02/05) défendent souvent l'ordre de réalisation [1]. A l'inverse, les plus jeunes qui ont grandi avec le personnage d'Anakin Skywalker voit plus de logique à suivre le personnage grandir et évoluer de film en film.
 Disney règne en maître sur le box-office mondial suite aux rachats et à l'exploitation commercialement intelligente des droits de Marvel et de Lucasfilm. Pourtant si le public visé semble comparable, dans les faits, on constate des nuances significatives pour ces franchises nées dans les années 60 et 70. Le public des blockbusters est sociologiquement différent de celui des comédies françaises ou des films d'auteurs. Cette intuition partagée par le public se vérifie dans les études sur la sociologie du public ou les approches marketing menées désormais régulièrement par des instituts spécialisées. Même si derrière cette hétérogénéité de la structure du public se cache aussi des spectateurs omnivores qui n'hésitent pas à consommer du cinéma sous toutes ses formes. Il y a un public qui ne se déplace que si ça vaut le coup, c'est à dire là où il y a du "money shoot" qu'on ne voit pas ailleurs et d'autres qui refusent d'aller en salles pour voir une énième version des gentils contre les méchants dans un monde qui n'a rien à voir avec la "vraie vie".
Il est difficile de définir le public les blockbusters car chaque année le nombre de films dépassant 4 millions de spectateurs est assez faible : À peine trois à cinq par an. De fait, la structure de ce public varie selon qu’on y trouve des dessins animés des comédies ou des films d’action. Steven Spielberg a confirmé récemment qu'Harrison Ford allait reprendre son rôle d'Indiana Jones pour un cinquième épisode (avec toujours John Williams à la musique). A 78 ans au moment de la sortie prévue, c'est un choix courageux pour certains, anachronique pour d'autres. Quelles étaient les autres options pour le studio ? Alors que 80% du top10 au box-office américain de l'année 2015 était des suites ou remakes, la question du renouvellement des franchises se pose avec le vieillissement des héros. Le cinéma de franchise existe depuis le cinéma muet qui a très vite compris l'aspect fidélisant de s'appuyer sur des héros récurrents (Bébé, Fantomas...). La caractérisation des personnages non parlants permettait de retrouver le même héros - interprété au moins par le même acteur - sans qu'on sache vraiment si c'était le même personnage (Buster Keaton, Charlie Chaplin...). Rappelons que le nom de Charlot dans les titres des films de Chaplin est une réalité française qu'on ne retrouve pas dans les titre originaux [1].
Pour autant, pour des raisons économiques évidentes, il est bien difficile d'abandonner une franchise à cause d'un personnage vieillissant d'autant que le monde fictionnel s'autonomise facilement du monde réel. Le public est fidèle non pas seulement à un concept qui a fait ses preuves, mais aussi à la connivence qui s'est créée avec un personnage récurrent comme un ami que l'on connait depuis longtemps et à qui on pardonne volontiers ses faiblesses. C'est un phénomène similaire qui permet de créer une addiction à des héros de série même lorsque la qualité chute progressivement. Reprendre un acteurs iconique d'une saga pose à un moment quelques problèmes : compte tenu de l'existence d'un désir mimétique, les héros jeunes attirent plus et les phénomènes d'identification ne sont pas favorables à conserver un acteur âgé pour toucher un public plus jeune, au risque de réduire l'audience et donc le succès. C'est pour être franchement orienté vers le renouvellement de son public que le producteur Steven Spielberg renonça dès l'origine à inclure l'un des acteurs-vedettes des premiers films pour Jurassic world. Par ailleurs, lorsque le succès est là il y a naturellement inflation. C'est pour une raison de gros sous que Robert Duvall n'est pas dans Le parrain 3 (il avait demandé le même salaire qu'Al Pacino)  Parmi les vedettes du cinéma français, Jean Dujardin a un forte côte d'amour auprès des spectateurs. Il a su transférer sa notoriété de la télévision au cinéma, en élargissant même ses rôles au-delà de la franche comédie. Pourtant, Un homme à la hauteur n'a pas atteint le score attendu malgré un casting, un sujet et une réalisation qui contenaient apparemment tout ce qu'il faut pour faire un succès. Jean Dujardin est un acteur populaire dans le plus beau sens du terme. Il fait un cinéma que les spectateurs aiment voir : des comédies burlesques, des comédies, des comédies romantiques, des comédies policières et mêmes des thrillers purs et durs. A chaque fois le public suit. Il a titillé le sommet avec Brice de Nice qui l'a imposé au cinéma à partir d'un personnage créé pour la télévision (avec les Nous ç nous) et depuis, il n'a jamais déçu permettant à des films pas si simples (Le bruit des glaçons, Un balcon sur la mer, Möbius) de rencontrer des succès tout à fait convenables. Et tout semblait bien parti pour Un homme à la hauteur. L'acteur avait enchaîné 5 films à plus de un million de spectateurs avant d'approcher ce seuil avec Un + une, le dernier Claude Lelouch qui n'avait pourtant plus atteint ce score depuis vingt ans. Sa partenaire, Virginie Efira, avait montré sa capacité à porter un film avec 20 ans d'écart (1.400.000 spectateurs). Quant au réalisateur, Laurent Tirard, c'est devenu une valeur sûre du cinéma français, capable de transposer avec talent l'univers de René Gosciny dans le très réussi Le petit Nicolas ou de ramener les français voir Molière au cinéma (1.200.000 spectateurs). Reste enfin, le film lui-même. C'est une comédie romantique grand public à concept. Un bon point pour attirer les foules dans un genre qui n'a rien à envier à L'arnacœur (3,8 Millions) ou Hors de Prix (2,1 M). Et pour couronner le tout, le film est réussi : les dialogues sont sympathiques, les acteurs font le job, la mise en scène apporte du rythme et les situations leur part d'originalité convenablement balisée. Le concept avait été testé avec succès puisque c'est le remake - à l'intrigue similaire à l'original argentin d'ailleurs - du film Corazon de Leon qui avait très bien marché en Argentine. Rien à dire et le public s'est dit globalement satisfait : 3,4 (sur 5) sur Allociné, la troisième meilleure performance des films avec Jean Dujardin en rôle principal. Et pourtant.
 La semaine est marquée par quelques suites atypiques qui arrivent sur les écrans ou dont le projet vient d'être annoncé. Fruits d'une tendance nostalgique ou solutions de producteurs pour réduire son risque, ses films marquent une démarche de recyclage parfois étonnante Cette semaine, on a appris en France le projet de donner une suite aux Aventures de Rabbi Jacob, la comédie devenue culte avec Louis de Funès. Il s'agira d'y raconter les aventures de Rabbi Jacqueline avec notamment Danièle Thomson à l'écriture comme pour le premier film réalisé par son père. Aux Etats-Unis, c'est un scénario de la jeune actrice Jen d'Angelo qui fait parler de lui alors qu'il n'est pas encore acheté par le moindre studio. Il s'agit d'un potentiel spin-of de Titanic focalisé sur des personnages secondaires du film de James Cameron qui s'est retrouvé sur la fameuse Black list des scénarios les plus en vue à Hollywood [1]. A Rosencrantz and Guildenstern Are Dead take on Titanic. An overprotective mother attempts to keep her teenage daughter, young son, and rowdy sister together while sailing on the doomed voyage of the Titanic in 1912. Ce qui étonne dans les deux cas, c'est que les deux films n'appelaient pas naturellement une suite. Le décès des acteurs de l'original et l'histoire concept du second rendaient l'idée de suite bien peu spontanée. C'est faire peu de cas de l'imagination de l'esprit créatif des artistes. La fausse bande-annonce suivante de Titanic 2 rassure quant à la possibilité d'en rajouter toujours un peu plus après la fin d'un film [2].
 L'époque où la cinémathèque ne diffusait que quelques obscurs chefs d'œuvre bulgares en complément d'une programmation dévolue à Yasujiro Ozu et Dziga Vertov est révolue. L'institution s'est ouverte à d'autres moyens de mise en valeur du patrimoine cinématographique depuis son rapprochement avec la BIFI (Bibliothèque du Film). Le 10 avril, sera projeté Le jouet de Francis Veber, une plaisante comédie qui fait aimer le cinéma justement. Le Jouet est un film de son époque. Il traduit bien une société "giscardienne" avec ses grands patrons confortées par la politique de Pompidou, les débuts de la crise économique et la guerre des classes exacerbée par les manifestations de la fin des années 60. C'est aussi les débuts d'un nouveau genre comique auquel le Francis Veber scénariste a participé avec son interprète Pierre Richard et sa candeur presque poétique.
Le film n'est pas manichéen approchant la question déjà débattue dans des contextes différents de savoir qui est le monstre entre celui qui donne les ordres et celui qui les accepte. Le débat dépasse l'opposition entre le patron et l'ouvrier pour glisser aux relations entre le chef et le sous-chef aux ordres (via le personnage du rédacteur en chef), le chef de famille et son épouse docile ou encore le père et le fils. Chacun accepte un rôle et s'en accommode plus ou moins. C'est aussi un film sur l'humiliation. Ce scénario malin vaudra à Francis Veber une nomination aux César 1977 et le droit à un remake américain six ans plus tard, The toy, avec Richard Pryor dans le rôle de Pignon [1].  Les premiers résultats viennent de tomber pour l'Episode 7 de Star wars : un premier jour record aux Etats-Unis avec 120 M$ et un "seulement" douzième premier mercredi en France avec 619.000 spectateurs en un jour. Comment faut-il comprendre ces chiffres ? Le dernier épisode de la saga Star wars est sorti il y a quelques heures que déjà, l´après-midi même, les observateurs scrutaient le score de la première séance. En France, on a parlé de déception et on annonce un triomphe chez les américains.
[mise à jour : avec finalement plus de 10 millions de spectateurs au final en France, le mot déception est bien relatif et montre que le succès du film est aussi lié à un accueil favorable du grand public, et pas seulement à l'attirance des fans de la saga] Le film est sorti en première mondiale mercredi, un jour avant les États-unis. Une exclusivité étonnante quand on sait à quel point le film jouit d´une aura particulière pour le public américain par rapport au public français. Chez les américains, il est certain que Le réveil de la force a frappé en fort en dépassant de 30% de le précédent record porté par le dernier épisode des aventures d'Harry Potter (91 M$). Le film de J.J. Abrams, qui reprend le flambeau laissé par George Lucas depuis la revente à Disney de tous les droits de sa franchise, écrase même le record pour un mois de décembre en rapportant plus que le weekend-end record de Le hobbit qui en trois jours avait fait 84 M$. C'est dire l'exploit du jour (l'analyse par boxofficemojo ici). Certains pourraient chercher à mesurer par rapport au symbole de la saga dans la culture américaine. Mais, là encore la seconde trilogie donne un axe de comparaison qui permet de mesurer la performance de ce 120 M€ en un seul jour (on imagine 250 M$ sur le weekend). La Fox vient de supprimer les deux films sur les 4 fantastiques sortis en 2005 et 2007. Elle laisse la place à son reboot qui sort cette semaine. Une stratégie dangereuse qui efface le passé au profit de la nouveauté.
S'inspirant du succès des films Marvel, la 20th century Fox a décidé il y a deux ans de relancer les aventures de Reed Richard, Benjamin Grimm et des frères et sœurs Storm. Ce groupe de super-héros créé par Marvel en 1961 est exploité par la Fox au cinéma depuis dix ans, échappant donc au rachat par Disney. Les films précédents avaient connu un semi-succès (600 M$ cumulés au niveau mondial), suffisant pour lancer un second film mais pas assez pour continuer au-delà. Ces films avaient pris un coup de vieux depuis l'offensive Marvel lancée en 2008 avec Iron-Man. Le triomphe des héros DC Comics, Batman et Superman, sous le patronage de Christophe Nolan a conduit également la Fox à retenir un ton plus sombre que le style pop-corn des films de 2005/2007. Il n'y a eu que huit ans avant de relancer la franchise. C'est peu, mais ce n'est pas si exceptionnel. Le reboot de Spiderman était revenu cinq ans après (2007/2012) et Hulk tout autant (2003/2008). Les exemples sont nombreux pour montrer que le public est prêt à y retourner sous réserve de retrouver ce qu'il a aimé avec néanmoins de la nouveauté. James Bond fonctionne ainsi depuis 24 films au rythme d'un film tous les deux ans environ.  L'affiche du film français, Un moment d'égarement (2015), a créé une petite polémique récemment sous l'impulsion de l'actrice Frédérique Bel (ex-blonde de Canal+) car le nom des deux actrices principales n'était pas repris sur l'affiche contrairement à celui des deux comédiens masculins : "ils ont aussi égaré le nom des actrices ?" avait-elle ironiquement demandé sur Twitter. Il n'en a pas fallu d'avantage pour entendre des accusations de sexisme. Nous ne rentrerons pas dans le débat de savoir si la société ou le monde du cinéma est sexiste, sans pour autant minimiser l'importance de l'enjeu sous-jacent. En revanche, nous nous étonnons de voir une telle polémique alors qu'une affiche est construite selon trois principes :
 Jurassic World est un énorme succès ; c’est entendu ! Il remet au gout du jour le bestiaire préhistorique du film original de Steven Spielberg, au sens propre comme au sens figuré. Nous revenons ici sur le regain d’appréciation observé par le film original depuis plusieurs mois.  Quelques semaines après le revival Mad Max, c’est au tour des dinosaures créés par Michael Crichton de revenir en force. Jurassic World est globalement bien accueilli avec une note IMDB assez haute de 7,6 sur 10 et une moyenne de 3,9 sur 5 chez les internautes d’Allociné. L’observatoire de la satisfaction, qui mesure l’audience du mercredi de la sortie en France, dépasse le recensement des seuls internautes et donne un taux de satisfaction de 93% (45% pour la haute satisfaction), ce qui est élevé surtout pour un blockbuster. Le même organisme constate dans les avis positifs que cette suite « offre son lot de créatures effrayantes, de scènes d’action musclées, d’effets spéciaux réussis, et donc d’émotion forte. C’est très impressionnant, on y trouve aussi une bonne dose d’humour et pas mal de clins d’œil au premier opus ». Les points négatifs portent sur « le scénario assez mince, pas toujours crédible » et le fait que « ce n’est pas assez ébouriffant, et ce n’est pas très novateur ». Avec 208 M$ en trois jours aux États-Unis et près d'un milliard de dollars en dix jours dans le monde entier, les records sont battus rapidement. De toutes les façons, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, puisque le développement des marchés émergent (le marché chinois a dépassé le marché américain pour la première fois en février 2015) contribue à voir les records tomber alors que l’effet 3D et l’inflation dopent également le prix du billet, donc les recettes. La France résiste un peu, le score de la 1ère semaine étant inférieur à celui de Fast & furious 7. Mais on chipote : Jurassic world est un triomphe partout où il sort. Ce succès s’appuie sur la réputation de la première trilogie lancée par Steven Spielberg et dont la cote d'amour du premier épisode reste élevée :
 Sortir une suite 30 ans après le précédent épisode était risqué. Pourtant les producteurs n'ont pas hésité à investir 150 M$ dans le nouveau Mad Max avec comme objectif d'attirer un nouveau public tout en capitalisant sur la notoriété acquise auprès du public de la trilogie originale. Une dizaine de jours après sa présentation au festival de Cannes et la sortie mondiale, on peut s'interroger s'ils ont réussi leur pari. La saga Mad Max semble appartenir à une autre époque. Elle est née à la fin des années 70, alors que le sous-genre des films post-apocalyptiques était à la mode, dans une période où les bikers et les punks étaient populaires. Le premier film s'affirmait aussi dans la tendance des films de vengeance qui touchaient alors aussi bien le genre policier (Un justicier dans la ville avec Charles Bronson) que le film d'horreur (la dernière maison sur la gauche de Wes Craven ou Carrie de Brian De Palma). Et surtout le pétrole apparaissait plus que jamais comme l'or des sociétés modernes après deux chocs pétroliers. Depuis les années 80 et le retour à un certain ordre moral est passé par là. L'apocalypse s'exprime dans le monde d'aujourd'hui avec le retour des films-catastrophe (2012, Contagion, San Andreas), et l'avenir de notre monde devenu numérique est le plus souvent décrit sous forme de dystopie (Hunger games, Divergente). Le pétrole, lui, n'a jamais été aussi bon marché depuis longtemps. Ce n'était donc pas si évident que de penser que ce héros créé en Australie par un médecin autodidacte, George Miller, avec un petit budget serait de nature à s'imposer à l'heure où la concurrence des blockbusters américains est particulièrement vigoureuse. Le box-office ne manque plus de super-héros.  es suites ont existé pratiquement dès la création du cinéma. Leur place a néanmoins changé depuis 30 ans avec l'évolution du secteur de l'industrie cinématographique dans son ensemble. La dynamique qui a présidé à ce changement mérite d'être rappelée. Les suites au cinéma ne sont pas une nouveauté. Au contraire, à l’époque du cinéma muet, les héros récurrents, dont Charlot est sans doute l’exemple le plus connu, sont courants. Comme aujourd’hui, les genres de la comédie (Bébé), du fantastique (les vampires), du policier (Fantomas) et des films d’aventure (Tarzan) développent des series de films, appelées parfois feuilleatons, qui incitent le spectateur à revenir. Même des auteurs comme Fritz Lang (Docteur Mabuse) réalisent des suites. Ce qui est peut-être nouveau à propos des suites, c’est que les producteurs leur prêtent davantage d'ambition, affectant des budgets plus conséquents qui contribuent à les positionner différemment. Dans les années 70, il est admis que les suites fonctionnaient moins bien que le film original. Superman 2 ou le retour du Grand blond ont fait moins au box-office que leur prédécesseur sans surprise. Parfois la suite d’un très gros succès est rapidement oubliée : qui se souvient Oliver's story la suite de love story ou more american graffiti qui a succédé à American graffiti ? |
Docteur en Sciences de l'information et de la communication, Laurent Darmon est devenu par cinéphilie un spécialiste de la réception cinématographique et de la sociologie du cinéma.
Il est l'auteur d'une thèse sur "l'itinéraire de l'évaluation d'un film par le spectateur au cinéma", anime des conférences et a été le Président de la Commission Cinécole 2016. Parallèlement, il est en charge du digital dans une grande banque française.
|






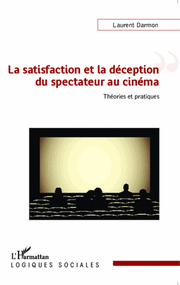

 Flux RSS
Flux RSS

