
30 ans aujourd’hui après sa sortie, la liste de Schindler est considéré comme un film emblématique pour décrire la Shoah aux jeunes générations. Alors que les derniers survivants disparaissent, le film n’en a pris que plus d’importance.
Pourtant le film fit l’objet d’une polémique à 3 niveaux :
· Ce que l’on montre - Peut-on décrire la Shoah en racontant l’histoire d’un nazi sauveur de juifs ?
· Qui le montre - Peut-on montrer la folie nazie dans un film hollywoodien signé du maître du blockbuster de divertissement ?
· Comment on le montre - Peut-on construire un suspense autour de ce qui sortira (eau ou gaz ?) d’une douche d’un camp de la mort, travelling à l’appui ?
À sa sortie, les Cahiers du cinéma écrivaient « un tel débordement de vertus positives ne peut conduire qu’à l’accablement, à l’écœurement, à la lassitude, surtout que ça dure plus de trois plombes ». Déjà en 1961, ce journal cinéphile refusait l’utilisation d’un travelling dans Kapò, film se déroulant dans un camp nazi.
Surtout la polémique fut animée par Claude Lanzmann, auteur de l’important documentaire Shoah, pour qui ce « film hollywoodien transgresse parce qu'il "trivialise", abolissant ainsi le caractère unique de l'Holocauste ».
Pour la postérité pourtant, alors que Shoah témoigne d’un destin collectif, la Liste de Schindler met en scène une histoire singulière qui interroge la conscience de ceux qui n’ont pas agi. Le cinéma y revendique son « principe d’efficacité » pour être édifiant (selon les mots d’Alain Minc et Anne Sinclair).
Steven Spielberg parvient à raconter l’Indicible : ce qui est montré dit justement ce qui ne l’est pas, que ce soient les 1.100 juifs sauvés évoquant en creux les 6 millions de victimes ou la douche d’Auschwitz qui laisse sortir de l’eau pour rappeler les chambres à gaz. On ne montre pas toute l’horreur dans le film, mais elle est là pour le spectateur. Du moins pour le spectateur éclairé.
Acquérant les droits du livre dès 1983, Spielberg mit 10 ans pour se décider à le réaliser. Il ne valida le scénario qu’en comprenant comment montrer la prise de conscience de Schindler : à travers son regard qui suit la petite fille en rouge lors de la liquidation du ghetto de Cracovie. Le reste du film est en noir et blanc car Spielberg ne concevait pas de montrer l'horreur de l'Holocauste en couleurs.
La première et la dernière scènes démontrent sa volonté d’inscrire le film dans une réalité historique faisant écho au présent. Refusant toute rémunération, il dédia l’intégralité des profits à une fondation créée pour recueillir les archives des survivants. Poursuivant ainsi le travail de Lanzmann et inscrivant cette histoire comme un témoignage face à la « banalité du mal ».

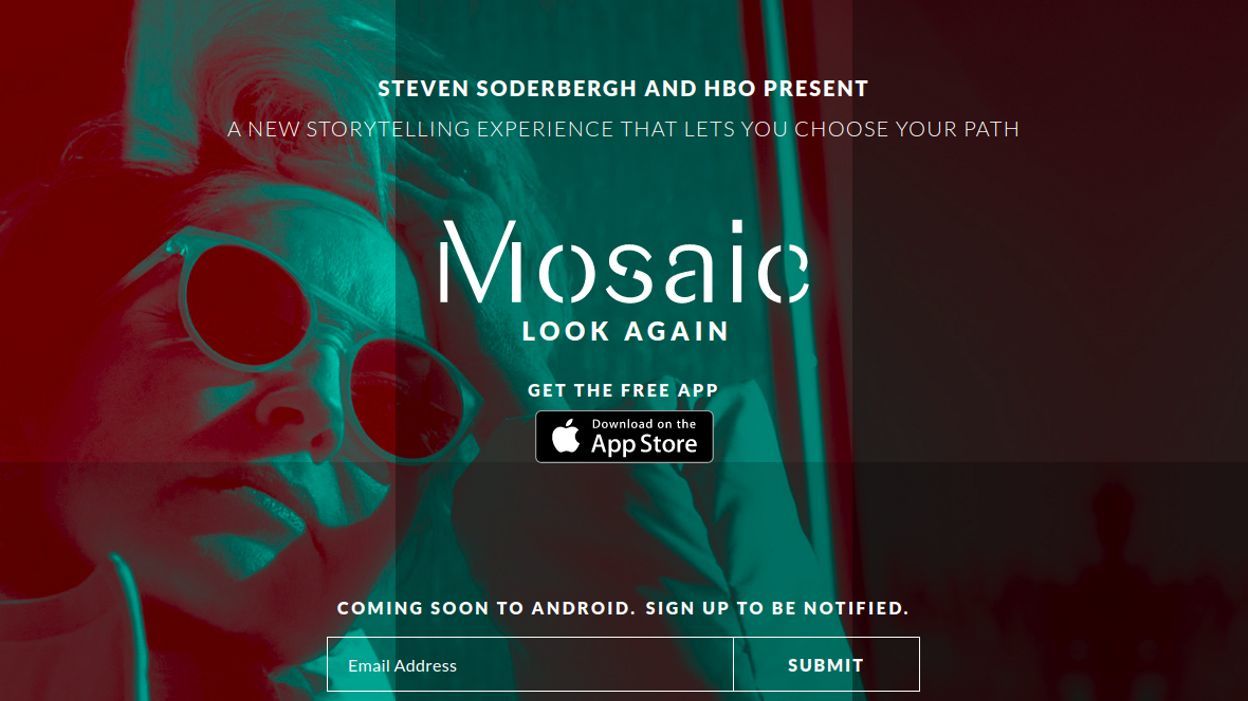
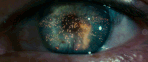

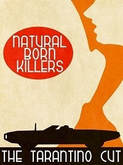
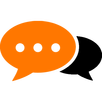














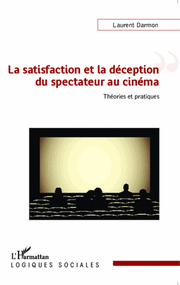

 Flux RSS
Flux RSS

