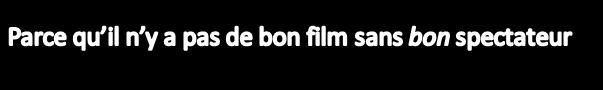Il est vrai que le public semble se répartir entre les cinéphiles toujours attachés à voir les films au cinéma et un grand public prêt se déplacer pour regarder sur grand écran des films à grand spectacle. Un peu à l’image de la fameuse « disparition des films du milieu » annoncée par Pascal Ferran en 2007.
La franchise raconte une Amérique dystopique (le premier film se déroule en 2022) où le gouvernement a rendu légal tout crime, y compris le meurtre, perpétué pendant une nuit de 12 heures définie légalement. Chaque film raconte une de ces journées où « la suspension du contrat social renvoie l'humanité à un temps de lutte à mort pour sa survie » (Le Monde)
Des séries B à petit budget qui connaissent un succès disproportionné, ce n’est pas nouveau : Paranormal activity et Blair witch avait même été tournés pour bien moins, mais c’était dans un modèle de financement amateur. Il existe une économie spécifique au cinéma d'horreur à petit budget destiné aux salles avec des films s'amortissant sur les premiers jours d'exploitation. Le producteur de The Purge, Jason Blum, s’en est fait une spécialité : après Paranormal activity [1], on lui doit Insidious, Sinister, Ouija, The Visit ... Et rien qu'en 2017, on lui doit Get out (252 M$ de recettes en salles) et Split (280 M$) pour des budgets toujours pour des budgets plafonnés de respectivement 4,5 et 9 M$ [2].
Déjà en 1968, La nuit des morts vivants avait montré qu’avec une très faible mise de fonds, le producteur pouvait générer des recettes importantes sans bénéficier d’une exposition marketing de premier ordre (30 M$ de recettes d'époque pour un budget de 114.000$). Six ans plus tard, Massacre à la tronçonneuse ne coûtera que 85.000$.
Dans les années 60, pour voir ces films, il fallait encore se tourner vers les séances de minuit ou de cinéma à double programme. Le succès phénoménal fin 1973 de L’Exorciste changea légèrement le regard de la profession, mais c’est la vidéo dans les années 80 qui permis réellement à ce cinéma de gagner de nombreux spectateurs. A de rares exceptions (Le 6ème sens, Le Silence des agneaux ...), le cinéma d’horreur reste un cinéma de genre consommé par une partie seulement du public : au-delà du cœur des fans, on y retrouve un public de jeunes adultes en mal de sensation (d’où une fréquentation particulièrement élevée pour les séances du vendredi et du samedi soirs entre amis : 45% des trois premiers jours contre 35% pour les blockbusters).
Néanmoins avec un public naturellement réduit, il y a une économie réelle pour faire des films à petit budget pour un spectateur potentiel fidèle dès que la qualité minimum et un brun d’originalité sont au rendez-vous.
Certes, certains parviennent quand même à progresser éventuellement jusqu’au troisième en accueillant de nouveaux fans grâce à l’exploitation du premier puis du deuxième film de la saga : Freddy, Resident evil, Saw (le 2ème film est le plus gros succès), Insidious.
|
Film
|
BO
USA/Canada |
BO
Reste du monde |
Budget
|
||
|
The Purge 1
|
64 M€
|
25 M€
|
337.136
|
89 M€
|
3 M€
|
|
2 : Anarchy
|
72 M€
|
40 M€
|
537.534
|
112 M€
|
9 M€
|
|
3 : Elections
|
79 M€
|
40 M€
|
702.611
|
119 M€
|
10 M€
|
|
4 : Les origines
|
68 M€
|
53 M€
|
1 000 000
|
121 M€
|
13 M€
|
Il faut dire que l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump qui a libéré une parole des conservateurs pro-armes d’extrême-droite donne de la crédibilité aux hypothèses du pitch et à l’ambiance paranoïaque des films : « Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste de l’année, les Nouveaux Pères Fondateurs testent une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée ».
Les retours des spectateurs sur les films sont globalement assez moyens mais le succès est bien là. Il faut croire que le concept touche profondément le public. Entre la volonté de pouvoir « purger » ses désirs malsains et la crainte d’être victime de la violence urbaine décrite par les médias, chacun peut se sentir concerné par ce double rôle schizophrénique. D'autant que la morale est sauve puisque ce sont les riches qui libèrent leur instinct primaire contre les pauvres.
D'abord, la vision vantée par le philosophe Hobbes d'un homme mauvais qui doit donc assumer sa part animale : sans la société, l'homme en est réduit à l'état de nature, c'est-à-dire un état de "guerre de tous contre tous". La nuit de Purge permet, à ce titre, une étape sacrificielle exprimant ce qu'il y a de pire chez l'individu.
Ensuite, les films posent les héros en victimes qui cherchent à fuir le mal car l'homme est foncièrement bon. Dans le quatrième épisode, dans une vision complotiste, lorsque la première Purge est mise en place, il n'y a pas spontanément de déversement de violence comme attendu et il faut que l'Etat fasse intervenir des mercenaires pour déclencher "l'inévitable".
Avec la série des films American nightmare, chacun est l'Ange et la Bête.
[2] - Ces films battirent même aux États-Unis le score de franchises établies aux budgets pharaoniques comme Pirates des Caraibes (5) et Transformers (5)
[3] - Ne sont retenus dans cette analyse que les sagas d’horreur (avec la classification Restricted) ayant au moins quatre films sortis.
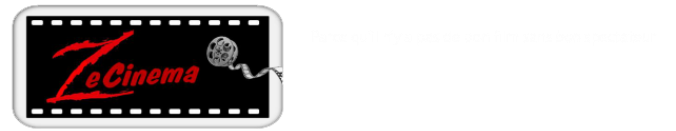



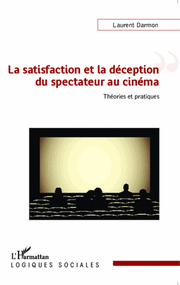
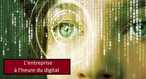
 Flux RSS
Flux RSS